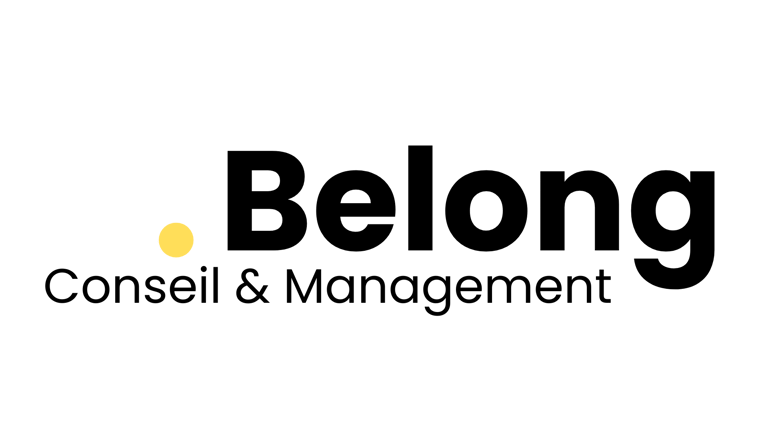Management : L’intelligence émotionnelle, levier stratégique dans un contexte de tensions accrues
Entre les réorganisations fréquentes, les injonctions à la performance, le travail hybride et l'instabilité du climat social, le rôle de manager devient de plus en plus complexe. Et beaucoup de dirigeants le reconnaissent à demi-mot : ils avancent à l’intuition ! Les modèles de leadership autoritaire montrent leurs limites. Pourtant, la tentation du "contrôle" refait souvent surface face à l’incertitude. Résultat : désengagement progressif, tensions interpersonnelles, fuite des talents. Et au centre de ces dysfonctionnements, un dénominateur commun : l’incapacité à gérer et utiliser les émotions de façon constructive.


L’intelligence émotionnelle : ni molle, ni naïve
Popularisée dans les années 1990, l’intelligence émotionnelle (IE) désigne la capacité à identifier, comprendre et réguler ses propres émotions et celles des autres. En d’autres termes, il ne s’agit pas de devenir “plus gentil” ou “plus agréable” – mais plus lucide, plus stratégique, et plus responsable dans la relation à soi et aux autres.
Elle repose sur cinq compétences clés :
La conscience de soi : reconnaître ses propres réactions émotionnelles et en comprendre les déclencheurs.
La maîtrise de soi : contenir l’impulsivité, ajuster son comportement à la situation, maintenir le cap sous pression.
La motivation personnelle : garder une vision et une énergie orientée vers les objectifs, même dans l’adversité.
L’empathie opérationnelle : comprendre les dynamiques émotionnelles sans forcément y adhérer.
L’intelligence relationnelle : influencer, recadrer, mobiliser sans infantiliser ni écraser.
Loin des clichés sur la “bienveillance à tout prix”, l’intelligence émotionnelle permet de faire preuve de fermeté sans brutalité, d’écoute sans faiblesse, d’adaptabilité sans dilution des exigences.
Des enjeux concrets : performance, autorité et alignement
Un dirigeant doté d’intelligence émotionnelle n’évite pas les conflits – il les traite à la racine. Il ne cherche pas à “faire plaisir”, mais à construire un environnement de responsabilité partagée. Il ne fait pas disparaître les tensions, mais les transforme en matière à décision ou en levier d’évolution.
Un savoir-faire qui s’apprend
Le déficit d’intelligence émotionnelle n’est pas une faute morale. Il est souvent le fruit d’un parcours orienté expertise, chiffres, rapidité. Bonne nouvelle : ce n’est pas un trait de personnalité, c’est une compétence qui se travaille.
Quelques leviers pour initier une montée en puissance :
Apprendre à se réguler émotionnellement en situation de stress (sans quoi la lucidité décisionnelle s’effondre).
Conduire des feedbacks difficiles sans projeter sa frustration ou provoquer de résistance.
Lire les signaux faibles dans les équipes (fatigue, retrait, sarcasme, crispation) et y répondre avant la rupture.
Travailler ses mécanismes de défense managériale (contrôle excessif, déni, fuite, sur-investissement).
Ces pratiques nécessitent parfois un travail individuel profond : reconnaître ses angles morts, ses biais émotionnels, ses automatismes défensifs. Ce n’est ni confortable, ni immédiat. Mais les bénéfices sont à la hauteur de l’effort.
Un leadership plus robuste, pas plus doux
L’intelligence émotionnelle ne remplace pas la vision, la stratégie ou la rigueur : elle les soutient, les aligne, les rend soutenables dans la durée. Elle permet au dirigeant de reprendre la main là où les automatismes relationnels ou les tensions internes prenaient le dessus.
Dans un monde du travail en mutation, le manager n’est plus seulement celui qui sait, mais celui qui sait faire avec l’humain. Cela exige une forme de courage : celui d’aller voir ce qui se passe en soi pour mieux gérer ce qui se passe autour de soi.
Un luxe ? Non. Un impératif.
À l’heure où la complexité organisationnelle n’est plus l’exception mais la norme, ignorer la dimension émotionnelle revient à piloter un navire sans radar dans la brume.
Les entreprises qui refusent d’investir ce champ payent un prix élevé en désengagement, en turn-over et en perte de cohérence managériale. Celles qui s’y engagent sans tomber dans l’angélisme y gagnent en performance durable, en autorité apaisée, et en alignement stratégique.
L’intelligence émotionnelle n’est pas un supplément d’âme. C’est une compétence de pilotage. Et sans elle, les meilleurs leviers techniques peuvent s’effondrer sous le poids des tensions humaines non traitées.